|
|||||||||||
|
|
| 2016-05-03 |
Sésame, ouvre-toi ! |
| par Sudeshna Sarkar | VOL.8 MAI 2016 CHINAFRIQUE |
| Mots-clés: traductions littéraires ;compréhension |
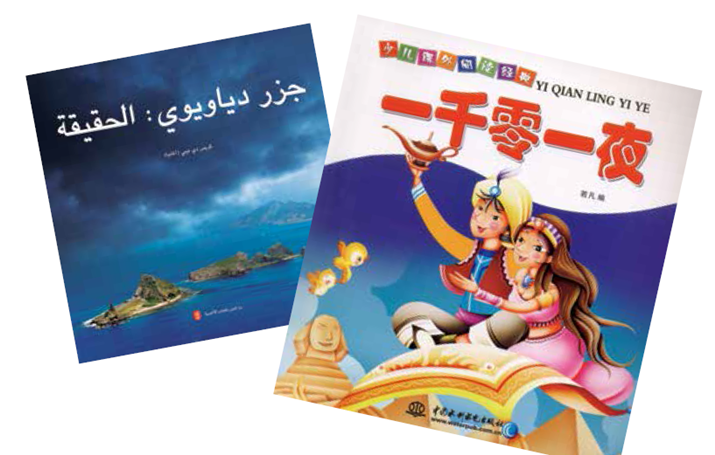
Il était une fois un jeune garçon qui trouva une lampe magique... Les enfants du monde entier continuent d’être fascinés par les aventures d’Aladin, qui voyait ses vœux exaucés par le génie de la lampe. Malgré les nombreuses reprises de ce conte – celle par exemple du Syrien anonyme d’Alep ou bien celle de l’explorateur britannique Richard Burton, qui au XIXe siècle traduit le conte pour les Studios Walt Disney – on a tendance à oublier qu’Aladin était un jeune chinois. Dans le conte original, l’histoire se déroule en effet dans « une des villes de Chine ». Il semble donc particulièrement opportun que Les Mille et Une Nuits, le recueil de contes populaires contenant l’histoire d’Aladin, soient l’un des premiers livres arabes non religieux traduits au chinois. C’est une sorte de retour à la maison pour le jeune Aladin. « Le premier livre d’histoires que j’ai lu quand j’apprenais le chinois enfant, en Libye, était une version abrégée des Mille et Une Nuits, appelée Tian Fang Ye Tan », raconte Wen-chin Ouyang, professeur de littérature arabe et comparée à l’École des études orientales et africaines de l’Université de Londres. « Les Mille et Une Nuits existent en chinois depuis les années 1900. »
La rencontre entre le chinois et l’arabe est pourtant bien antérieure. Elle remonte à l’arrivée de musulmans fuyant la guerre et de marchands le long de la Route de la soie. L’essor de l’islam a également développé l’intérêt pour l’arabe, puisque c’est la langue du Coran. Au XVIe siècle un intellectuel musulman, Hu Dengzhou, revient d’un pèlerinage à la Mecque avec des textes religieux en arabe, ensuite traduits au chinois. Les intellectuels et les enseignants ont traduit et expliqué les textes religieux arabes pendant les deux siècles suivants, leur corpus de textes devenant même un document historique, le Han Kitab. Han signifiant chinois, kitab étant le mot arabe pour livre. « Malgré le peu de traductions arabes disponibles à cette période-là, celles-ci ont permis aux lecteurs chinois de comprendre une autre réalité socio-culturelle », explique le bloggeur chinois Sha Min, très intéressé par la littérature arabe. « Après la création de la République populaire de Chine, en 1949, et l’établissement de relations diplomatiques avec les pays arabes, un bon nombre d’œuvres en arabe ont été traduites au chinois. »
Présenter la nouvelle Chine
Après 1949, les traductions se sont institutionnalisées. « Après la création de la République populaire de Chine (RPC), beaucoup de jeunes intellectuels sont revenus de l’étranger », raconte Hu Kaimin, rédacteur en chef adjoint aux Éditions des Langues étrangères, la maison d’édition du Groupe de publication international de Chine, créé en juillet 1952. « Ils voulaient la présenter au monde. Les premières traductions ont été faites du chinois à l’anglais, français et russe, expliquant la situation en République populaire et les politiques étatiques. Au fur et à mesure, la littérature chinoise et des livres sur la culture et l’économie du pays ont également été traduits. »
L’année 1956 a été essentielle dans les relations sino-africaines, avec l’établissement de relations diplomatiques entre la Chine et l’Égypte. Avec ce premier allié arabophone, l’arabe devient plus important pour la Chine. « Par ailleurs, l’arabe est une des langues officielles et de travail des Nations unies, parlé en Afrique du Nord et au Moyen-Orient », rappelle Hu. « Nous avons désormais un département dédié à l’arabe et une grande partie de nos publications sont en arabe. » Depuis les années 1960, les Éditions des Langues étrangères ont traduit les œuvres de Mao Zedong en 43 langues, dont l’arabe, l’haoussa et le swahili.
De ni hao à marhaba
Wang Hao dit avoir découvert le monde arabe par « accident ». À 18 ans, il veut être accepté à la prestigieuse Université des Langues étrangères de Beijing. Pour augmenter ses chances d’acceptation, il décide de postuler aux études arabes, peu prisées par les autres étudiants. À 34 ans, Wang est désormais directeur du département d’arabe des Éditions des Langues étrangères. Le département est composé de trois Chinois et d’un expert irakien. S’étant rendu à la Foire du livre d’Abou Dabi, Wang constate que les lecteurs arabophones sont très intéressés par les livres de médecine traditionnelle chinoise et d’arts martiaux. Outre les documents politiques, les livres blancs et les livres expliquant l’économie chinoise, le département d’arabe traduit les classiques de la littérature chinoise.
Les quatre grands classiques de la littérature chinoise ont déjà été traduits à l’arabe : Au bord de l’eau (une fiction du XIVe siècle faisant le récit d’une révolte, généralement attribuée à Shi Nai’an) ; Les Trois Royaumes (également un roman historique du XIVe siècle écrit par Luo Guanzhong) ; Le Pèlerinage vers l’Ouest (roman de Wu Cheng’en racontant les aventures d’un moine) ; Le Rêve dans le pavillon rouge (une saga du XVIIIe siècle où Cao Xueqin dévoile les vicissitudes de sa famille et celles de la dynastie au pouvoir). Des classiques de la philosophie chinoise – tels que les textes de Mencius, le penseur itinérant souvent reconnu comme le plus célèbre des confucianistes après Confucius lui-même, ou les textes du taoïste Zhuang Zhou – ont également été traduits à l’arabe. Alors que le monde entier commémore le 400e anniversaire de la mort de William Shakespeare cette année, c’est également le 400e anniversaire de la mort de Tang Xianzu, rappelle Wang. Le dramaturge chinois (1550-1616) est célèbre pour Mudan Ting ou Le Pavillon des pivoines, l’histoire de deux amoureux unis malgré les obstacles, pièce ayant connu un grand succès durant la dynastie des Ming (1368-1644).
Des liens locaux
Par un heureux hasard, les traductions du chinois à l’arabe et vice-versa ont une réelle utilité dans la région autonome hui du Ningxia, au nord-ouest de la Chine. La communauté Hui étant à majorité musulmane, beaucoup parlent l’arabe. Cette année, les Éditions des Langues étrangères publieront ainsi un livre illustré sur le peuple Hui, en arabe. Ahmed Al-Saeed, fondateur de Sagesse-Maison de publication des cultures et des médias, habite à Yinchuan, capitale de Ningxia. L’Égyptien de 34 ans a étudié le chinois à la célèbre université Al-Azhar du Caire. Il arrive à Ningxia en 2010 pour une mission de traduction et ne doit rester que trois mois. Mais l’agréable atmosphère de la région le pousse à s’installer à Yinchuan, où il épouse une Chinoise et ouvre sa maison d’édition. Sagesse a déjà traduit près de 20 livres chinois à l’arabe, et espère traduire 200 livres chinois et arabes d’ici 2018. Saeed choisit des thèmes qui peuvent intéresser les lecteurs arabes en dehors de Chine : la littérature, la culture et l’histoire des Hui. « Les Arabes ont hâte d’en savoir plus sur l’économie et le développement chinois », confiait-il à l’agence de presse Xinhua.
|
|||||
|
||
| 24 Baiwanzhuang, 100037 Beijing République populaire de Chine | ||
| Copyright CHINAFRIQUE tous droits réservés 京ICP备08005356号 |